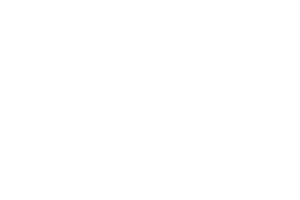Sécurité au travail : le grand malentendu

La sécurité au travail repose souvent sur l’idée que le risque doit être totalement éliminé, alors qu’il est impossible de l’éradiquer complètement. Cette illusion pousse à empiler les règles, au risque de déresponsabiliser les salariés et de créer un faux sentiment de sécurité. S’inspirer de l’aviation, qui accepte, anticipe et intègre le risque, permettrait de développer une véritable sécurité fondée sur les comportements.
L’illusion de la maîtrise absolue
Dans le monde de l’aviation, le risque est pleinement intégré. Il est reconnu, identifié, préparé. L’objectif n’est pas de l’éliminer – ce serait illusoire – mais de l’anticiper pour éviter l’accident. Ce dernier, en revanche, n’est jamais acceptable.
Les pilotes savent que la défaillance technique, la surcharge de travail, le stress ou encore la pression du temps font partie intégrante de leur environnement. Ils s’y préparent. C’est précisément cette lucidité qui permet à l’aviation commerciale d’afficher un niveau de sécurité aussi élevé. À titre de comparaison, si le secteur aérien connaissait le même taux d’accidents que le monde du travail, il n’aurait jamais pu se développer !
En entreprise, on continue pourtant à entretenir l’illusion qu’un empilement de règles, de dispositifs et de formations suffira à éliminer les accidents. Cette stratégie, bien que sincère dans son intention, montre aujourd’hui ses limites.
La première tient au fait que la réglementation ne peut pas tout prévoir. Les aléas du travail sont trop nombreux, trop variables. Imaginer qu’on puisse tout encadrer revient à croire qu’en apprenant uniquement la conduite technique, on évitera tous les accidents de la route. Or, dans l’aérien, la maîtrise du pilotage n’est qu’une composante de la sécurité. Le facteur déterminant, c’est le comportement. Sans cette dimension, la compétence technique peut même se retourner contre nous en favorisant un excès de confiance. Ce phénomène bien connu – l’attitude d’invulnérabilité – est à l’origine de nombreux drames sur la route.
L’autre effet pervers d’un encadrement trop rigide est la déresponsabilisation progressive des salariés. À force d’imposer des règles dans les moindres détails, on finit par ôter à chacun sa capacité à percevoir le danger.
Le risque devient alors abstrait, distant, géré par d’autres. Cette passivité affaiblit la vigilance. Pire, elle peut créer un faux sentiment de sécurité. Or, quand survient un imprévu – non prévu par les règles – la réaction peut être inadaptée, voire absente.
La culture du comportement, clé de voûte de la sécurité
Cela ne signifie pas qu’il faille renoncer aux règles. Elles sont indispensables. Chaque consigne de sécurité représente une barrière de protection. Le modèle de James Reason, souvent appelé « modèle du gruyère », illustre comment une série de failles – techniques, humaines, organisationnelles – peuvent s’aligner et provoquer un accident.
Une règle non appliquée, c’est une barrière qui disparaît. Le risque d’accident augmente alors mécaniquement. Mais il faut aussi reconnaître que sur le terrain, certaines règles sont vécues comme des entraves : elles gênent les gestes, alourdissent les processus, alimentent le stress.
Plutôt que d’empiler les consignes, il serait plus efficace d’accompagner les comportements. Le risque ne disparaîtra pas. En revanche, on peut s’y adapter, en cultivant une vigilance active, en développant une conscience collective du danger.
C’est là tout l’enjeu d’une véritable culture de la sécurité : non pas une accumulation de règles descendantes, mais un état d’esprit partagé, à tous les niveaux de l’organisation. Comme dans l’aéronautique, où chacun est acteur de la sécurité, et non simple exécutant.
Pour une sécurité fondée sur la responsabilité
Une société sans risque n’existe pas. Une vie professionnelle sans aléas non plus. Mais mourir au travail ne devrait jamais être considéré comme une norme.
Le jour où l’entreprise cessera de confondre encadrement strict et culture de sécurité, elle aura franchi un cap majeur. C’est en donnant à chacun les moyens de comprendre, de questionner, d’alerter et d’agir qu’elle fera reculer durablement le risque d’accident.